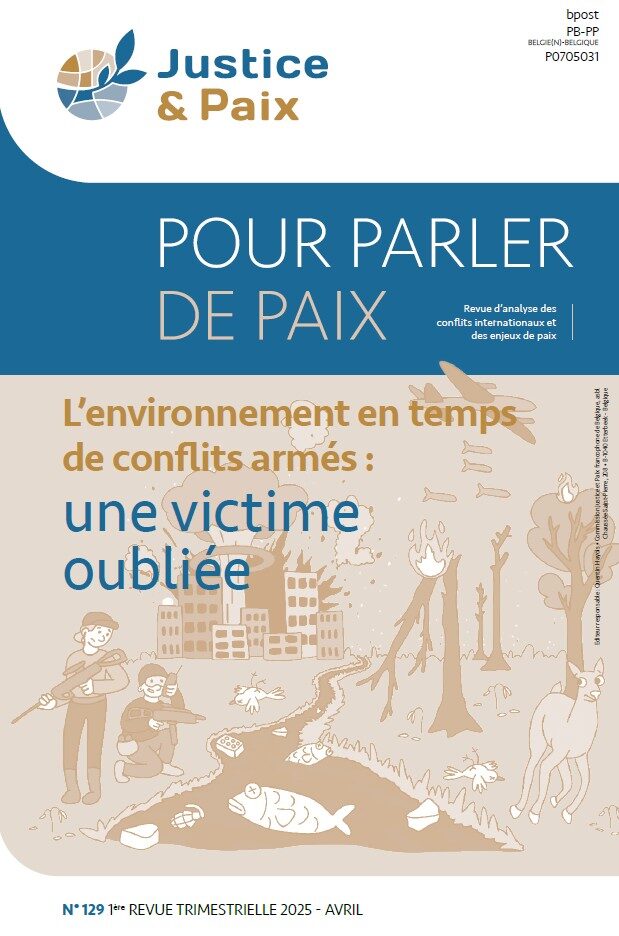Le retour des logiques de réarmement en Europe suscite de l’inquiétude. Justice & Paix interroge cette fuite en avant sécuritaire, soulignant qu’une paix durable ne peut être obtenue sans justice sociale, diplomatie active et respect du droit international.

L’Europe achève enfin de s’éveiller face à la perspective d’un conflit ouvert sur le continent qui s’étendrait au-delà de la ligne de front actuelle entre l’Ukraine et la Russie. L’agression russe en Ukraine a ravivé des réflexes sécuritaires que l’on croyait presque relégués aux manuels d’histoire. La réélection de Donald Trump, les propos de son vice-président à la Conférence de Munich sur la Sécurité puis cette scène glaçante dans le Bureau ovale où l’humiliation d’un président démocratiquement élu par le président de la nation la plus puissante du monde a finalement astreint l’Europe à changer radicalement son paradigme en matière de sécurité et de défense.
Un mot d’ordre quasi consensuel s’est imposé sur le Vieux Continent : il faut ré-ar-mer. Il faut réarmer à tout prix et surtout rapidement. Les budgets militaires explosent, les engagements à atteindre ou dépasser les fameux 2 % du PIB pour la défense sont pris les uns après les autres. Et tout cela semble désormais bien coordonné par la Commission européenne et son plan « ReArm Europe »[1] . La Belgique n’échappera donc pas à la règle : jamais, depuis la fin de la guerre froide, les moyens alloués au secteur de la défense ne vont connaître une telle augmentation.
En amont, des pays de l’Union européenne comme l’Allemagne, la Pologne ou la France (n’oublions pas non plus de mentionner la Grande-Bretagne) avaient déjà commencé à accélérer leurs programmes de modernisation militaire, tandis que de nouvelles coopérations industrielles européennes sont en train de voir le jour pour développer des capacités communes (avions de combat, systèmes de défense anti-aérienne, munitions, etc.). La France va même jusqu’à proposer l’élargissement de son parapluie nucléaire, rien de moins[2] !
Mais cette volonté de réarmement massif pose question : réarmer, certes… mais pour quoi faire ? Pour garantir la paix, vous diront ses promoteurs. Mais ce lien quasi automatique entre accumulation d’armements et paix durable mérite d’être interrogé. Quels efforts diplomatiques sont menés parallèlement pour ouvrir des perspectives de résolution du conflit en Ukraine ou prévenir d’autres foyers de tensions ? Quel espace est laissé aux initiatives de désescalade, aux approches multilatérales, ou encore au renforcement du droit international ?
Alors que l’Europe investit des centaines de milliards d’euros supplémentaires dans ses arsenaux, il faut rappeler qu’une sécurité authentique ne se construit pas seulement à coup de chars, de missiles ou encore de drones. Réarmer l’Europe, soit. Mais sans désarmer la paix. Echafauder une infrastructure de défense certes mais avec son pendant, la construction d’une vision pour la paix.
Une nette rupture historique
Pourtant, ce retour massif aux logiques de réarmement ne s’est pas fait sans rupture. Pendant plusieurs décennies, l’Europe, traumatisée par les conflits à ses portes et par la guerre froide, avait plutôt engagé une dynamique inverse. Les processus de désarmement multilatéraux, les traités limitant certaines armes, les réductions de dépenses militaires faisaient consensus, dans un contexte où l’intégration européenne elle-même se voulait un rempart à la guerre. Ce qu’on appelait alors le « dividende de la paix » avait permis de réinvestir dans les systèmes sociaux, les politiques éducatives, les infrastructures publiques, la coopération internationale.
Aujourd’hui, ce cycle semble, si pas complètement brisé, en tout cas sérieusement enrayé. Les raisons avancées sont connues par l’Union européenne : sentiment d’insécurité croissante, flux migratoires aux frontières perçus comme une menace, montée des régimes autoritaires et vague brune un peu partout sur le globe. Cependant, faut-il pour autant faire fi des leçons du passé et basculer sans réserve dans une logique où la paix serait censée se gagner essentiellement à travers des moyens militaires toujours plus conséquents ? L’analogie entre la Crise de 1929 et la crise financière de 2008 nous a été rappelée par l’ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis[3]. Si les clivages actuels ne sont plus tant identitaires, et c’est là sans doute les limites de son analogie, ils sont largement nourris par les dérives d’un marché économique mondialisé débridé et notamment par une compétition féroce pour l’accaparement des ressources naturelles, singulièrement des minerais stratégiques.
Des milliards d’euros investis dans l’urgence
La trajectoire budgétaire belge actuelle en matière de défense interpelle. En 2022, le gouvernement avait prévu que le budget de la défense passe de 4,4 milliards d’euros à 6,9 milliards à l’horizon 2029 (soit 1,54% du PIB). Une augmentation d’un peu plus de 55 % en 7 ans. L’objectif du gouvernement était clair : atteindre à terme les 2 % du PIB recommandés par l’OTAN. Adopté fin 2022, le plan STAR (Security, Technology, Ambition, Resilience) engageait la Belgique dans une modernisation de ses capacités militaires sur une période de 15 ans. Ce plan inclut l’acquisition de nouveaux avions de chasse F-35, des navires de guerre, des systèmes de défense aérienne, ainsi que des investissements dans la cyberdéfense et d’autres technologies.
Ce plan, accompagné de la mobilisation de crédits budgétaires complémentaires, ne serait-il pas finalement que le court générique d’un interminable péplum hollywoodien quand on apprend que l’atteinte des 2% du PIB fixée après 2029 il y a 3 ans est désormais fixée à juin 2025 ? Or, si cette réorientation massive des moyens publics s’opère dans l’urgence, nous voulons nous assurer que le temps des arbitrages qui vont s’imposer soit pris. Il faut peser les priorités budgétaires à l’aune des besoins sociaux, de l’urgence climatique, des engagements internationaux en faveur du développement durable, de la coopération internationale ou plus prosaïquement du maintien de notre sécurité sociale ou encore des politiques de lutte contre la pauvreté.
Réarmement vs. sécurité
Ce basculement n’est pas neutre. Sécurité pour qui et sécurité par quels moyens ? Justice & Paix défend depuis toujours une vision élargie de la sécurité des populations : celle qui repose sur des sociétés inclusives, des institutions démocratiques fortes, des économies justes et redistributives, des relations internationales encadrées par le droit international et non par l’utilisation de la force. À cet égard, le renforcement militaire sans vision globale à long terme risque de nourrir un cercle vicieux de violence. Chaque investissement militaire pousse les pays voisins à en faire de même, attise la méfiance, et verrouille les marges diplomatiques possibles. C’est la logique bien connue du « dilemme de sécurité » : en voulant renforcer notre protection, nous alimentons les tensions. Et ce faisant, nous détournons des ressources financières vitales pour d’autres urgences sociétales.
N’y a-t-il là finalement qu’une fatalité ? Doit-on désormais se faire à l’idée que l’Histoire est écrite et que rien, plus rien, ne pourra la changer ?
Les coûts cachés du complexe militaro-industriel
Un autre aspect préoccupant est le poids croissant des industries de défense dans l’économie européenne. Derrière les milliards d’euros investis se profilent des intérêts économiques puissants, peu enclins à encourager la désescalade. Le lobbying des grandes entreprises de l’armement auprès des institutions nationales et européennes façonne les priorités politiques, bien souvent loin des préoccupations des citoyens et citoyennes.
La Belgique, avec sa participation annoncée aux programmes industriels européens liés à la défense, s’inscrit dans cette dynamique. Or, une économie tournée vers l’industrie militaire est une économie qui va orienter ses compétences, ses capacités d’innovation, ses budgets vers des finalités conflictuelles, au détriment d’un développement humain, écologique, durable et solidaire. L’économie de guerre actuellement à l’œuvre en Russie en est un bon exemple qui ne laisse pas augurer une fin rapide du conflit entre les deux belligérants, voire entre l’Occident (ou ce qu’il en reste) et la Russie, tant le régime en place va vouloir garantir sa survie coute que coute.
Une société civile marginalisée
Face à cette accélération de l’Histoire et à ce phénomène d’hyper-actualité auxquels nous assistons depuis cette confrontation dans le Bureau ovale, une question nous hante : pourquoi si peu d’écho à la mobilisation citoyenne autour de ces choix cruciaux ? L’une des raisons est sans doute à chercher dans le climat actuel : les peurs sont légitimes, les menaces sont bien réelles, les images de guerre circulent en continu, le concept de guerre hybride nous est servi ad nauseam. Pourquoi, dans ce contexte, contester la nécessité de se protéger ? C’est précisément dans ces moments de tension que la société civile joue son rôle de vigie démocratique, pour interroger, proposer, alerter sur les risques de réponses simplistes et qu’elle doit être visibilisée pour être entendue.
Oser remettre la paix au centre
Faut-il pour autant céder à la résignation ? Certainement pas. Les alternatives existent, encore faut-il leur donner une place. Sur le plan international, la Belgique pourrait renforcer son engagement pour les mécanismes multilatéraux de désarmement : relancer les efforts autour du Traité d’interdiction des armes nucléaires (que la Belgique refuse toujours de signer[4] ), et renforcer les dispositifs de contrôle des exportations d’armes[5] .
Investir dans la prévention des conflits, dans le soutien aux droits humains, dans la coopération au développement, pourtant bien malmenée dans le dernier accord de gouvernement, est en outre un véritable levier de sécurité durable. Le constat est sans appel : les budgets correspondants stagnent, quand ils ne reculent pas. Ce déséquilibre doit être rectifié si nous voulons offrir un horizon crédible aux futures générations.
La tâche est difficile et elle sera ardue. L’opinion publique est travaillée par des logiques de peur et de repli, c’est audible et justifié. Les discours dominants, relayés par certains médias, certaines sphères politiques et l’effet d’emballement des réseaux sociaux valorisent la réponse armée comme seule voie raisonnable. Ils simplifient surtout ce qui reste une matière complexe, qui appelle à la nuance et au débat d’idées.
Justice & Paix affirme donc avec conviction qu’il n’est pas naïf de défendre la paix, y compris dans un contexte menaçant. C’est au contraire un acte de lucidité, pas une posture de neutralité. Car sans justice sociale, sans équité, sans respect du droit international, aucune paix ne sera durable. La militarisation à outrance ne répondra pas aux défis systémiques auxquels nos sociétés sont confrontées : crises environnementale et climatiques, crises sociales, migrations forcées, polarisation économique, montée des extrémismes, sentiment d’abandon d’une importante frange de la population. Le champ est labouré pour accueillir les graines du populisme.
L’accord de gouvernement de l’Arizona préconise l’instauration d’une « culture de la sécurité ». Justice & Paix promeut une véritable « culture de paix[6] » , comme levier essentiel pour déconstruire les logiques de violence et construire, dès aujourd’hui, les bases d’une société plus juste et plus solidaire. Cette culture de paix passe par l’éducation, par la capacité à gérer les conflits autrement, par le respect des droits fondamentaux, mais aussi par la participation active de toutes et tous dans la construction du vivre ensemble. Dans un contexte où la réponse militaire pourrait préempter tout le débat, il faut redonner toute sa place à cet engagement patient et de long terme pour la paix.
Quentin Hayois.
[1] Federico Santopinto. «Le plan ReArm Europe et la quadrature du cercle entre intégration et souveraineté nationale ». IRIS. 12 mars 2025.
[2] Cécile Ducourtieux, Philippe Ricard et Elise Vincent. « L’extension du parapluie nucléaire français et britannique en Europe suscite un intérêt grandissant de la part des alliés ». Le Monde. 4 mars 2025
[3] Simon Brunfaut. « Yanis Varoufakis: “Le plan de réarmement de l’Europe est une folie totale » ». L’Echo. 8 mars 2025.
[4] Samuel Legros. « Armes nucléaires présentes et futures en Belgique. Qu’en pensent les partis politiques ? ». CNAPD. 28 mars 2024.
[5] Carte blanche collective. « Exportation d’armes wallonnes : Il faut réformer le décret wallon pour plus de transparence et de contrôle ! ». Le Soir. 12 mars 2025.
[6] Justice & Paix. « La culture de paix ». Juin 2024.