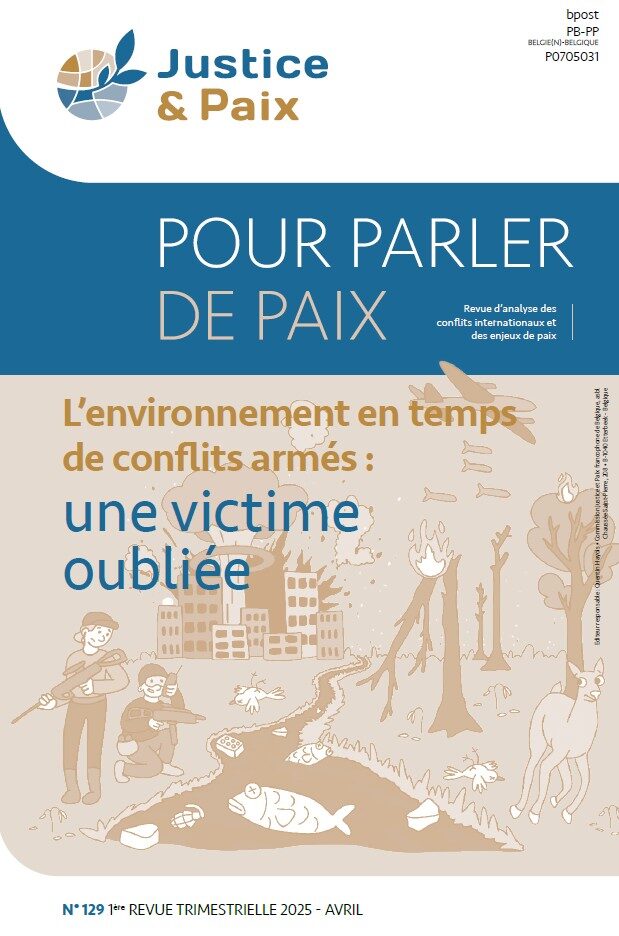Le conflit russo-ukrainien, déclenché le 24 février 2022, par l’agression de la Russie sur le territoire ukrainien, a plongé la région dans une crise profonde aux dimensions humaines, politiques et économiques considérables. Tentons de décrypter ces nombreuses dimensions à travers cet article!

Crédit photo : LukasJohnns
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine trouve ses racines dans une histoire commune qui remonte à plus d’un millénaire. Dès le XVIIIe siècle, l’Empire russe impose son autorité sur l’Ukraine et met en place une politique de russification, interdisant notamment la langue ukrainienne et renforçant l’influence culturelle et religieuse de Moscou.
La période soviétique a accentué cette domination, notamment avec l’Holodomor, la famine orchestrée par Staline dans les années 1930 qui a causé la mort de millions d’Ukrainien·nes. L’Ukraine est restée sous contrôle soviétique jusqu’à l’effondrement de l’URSS en 1991, où elle est devenue indépendante. Pourtant, cette indépendance n’efface pas les profondes divisions internes du pays.
Ces différences se sont cristallisées sur la scène politique, notamment lors de la révolution orange en 2004 et la révolution de Maïdan en 2014, où une partie de la population a manifesté son désir de rapprochement avec l’Union européenne. Ces mouvements ont été perçus comme une menace par la Russie, qui a réagi en annexant la Crimée en 2014 et en soutenant les séparatistes dans l’est du pays, notamment dans la région du Donbass. Depuis, l’invasion russe, la société ukrainienne s’est unie dans l’adversité.
Au-delà des rivalités historiques et culturelles, l’Ukraine est un enjeu géopolitique majeur. Riche en minerais stratégiques et traversée par le Dniepr, elle joue un rôle clé dans le transport et l’agriculture grâce à son accès à la mer Noire, notamment via la Crimée. L’Ukraine occupe donc une position stratégique entre la Russie et l’Europe.
Son éventuel rapprochement avec l’OTAN, l’alliance politico-militaire mise en place par les pays d’Europe et d’Amérique du Nord, représente une menace pour Moscou, qui cherche à maintenir son influence sur les anciennes républiques soviétiques et retrouver sa puissance d’antan.
Ainsi, le conflit actuel s’inscrit dans une continuité historique marquée par des tensions profondes et des rivalités de pouvoir qui dépassent largement la seule question ukrainienne.
3 ans après l’agression, quel bilan ?
Trois ans après le début du conflit, le bilan humain est dramatique. Les Nations Unies estiment à plus de 28 000 le nombre de victimes civiles, dont plus de 10 000 morts, bien que ces chiffres soient probablement sous-évalués. Le conflit a provoqué une crise migratoire d’une ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 6,3 millions d’Ukrainien·nes ayant fui dans les pays voisins et 3,7 millions de déplacés à l’intérieur du pays. La situation humanitaire reste critique, avec 14 millions de personnes nécessitant une aide d’urgence.
Sur le plan militaire, la situation évolue de manière contrastée. Si l’armée russe a progressé territorialement, son avancée reste lente et coûteuse. En début d’année 2024, elle contrôlait environ 17,61 % du territoire ukrainien, une proportion passée à 18,14 % en fin d’année. Cette progression, concentrée principalement dans le Donbass, s’est accompagnée de pertes humaines considérables.
De son côté, l’Ukraine a consolidé ses capacités défensives grâce à l’appui militaire occidental, néanmoins, Kiev reste confronté à d’importants défis, notamment en matière de munitions et d’effectifs, alors que le conflit s’enlise dans une guerre d’usure aux conséquences économiques et sociales lourdes.
Le front informationnel constitue un autre champ de bataille majeur. La désinformation et la propagande jouent un rôle central dans la perception du conflit en Europe et dans le monde. Les techniques de manipulation de l’information se sont sophistiquées, notamment avec l’usage de l’intelligence artificielle pour la création de contenus trompeurs. Ces campagnes cherchent à influencer l’opinion publique.
Par ailleurs, l’impact environnemental du conflit demeure un aspect largement sous-estimé. Les bombardements intensifs ont entraîné une contamination des sols et des eaux, notamment à cause des métaux lourds et des résidus d’explosifs. La destruction d’installations industrielles et énergétiques a généré des rejets toxiques dans l’atmosphère, compromettant durablement certains écosystèmes. À ces dégâts s’ajoute la pollution sonore intense, qui perturbe la faune et modifie les cycles de reproduction de nombreuses espèces animales.
Les dynamiques du conflit et quelques pistes de résolution
Face à cette situation critique, la réponse internationale s’articule effectivement à plusieurs niveaux, avec des résultats mitigés. Les mécanismes onusiens, paralysés par le veto russe, peinent à dépasser le stade des condamnations symboliques. Si l’Assemblée générale des Nations Unies maintient une position ferme contre l’agression russe, son impact concret reste limité aux aspects humanitaires.
Le droit international joue un rôle central dans la gestion du conflit, bien que son efficacité soit mise à rude épreuve. La Cour pénale internationale (CPI) a ouvert dès mars 2022 une enquête sur les crimes de guerre présumés commis en Ukraine. En 2023, elle a émis un mandat d’arrêt contre des responsables russes, dont Vladimir Poutine, pour déportation d’enfants ukrainien·nes, marquant une première historique contre un chef d’État en exercice d’une puissance nucléaire. Parallèlement, la Cour internationale de justice (CIJ) a été saisie par l’Ukraine pour statuer sur la légalité de l’invasion, mettant en évidence les violations du droit international par Moscou. Toutefois, l’absence d’adhésion de la Russie au Statut de Rome et les limites structurelles de ces institutions freinent l’application effective des décisions. Face à ces défis, des discussions ont émergé autour de la création d’un tribunal spécial pour juger le crime d’agression contre l’Ukraine. Soutenu par plusieurs pays européens, dont la Belgique, ce projet soulève des questions juridiques et politiques, notamment sur sa légitimité et la faisabilité de sa mise en œuvre en l’absence de coopération russe.
Les restrictions sur les exportations de technologies, l’exclusion de certaines banques russes du système SWIFT[1] et les embargos sur le pétrole et le gaz ont eu un impact significatif sur l’économie russe. Ces sanctions économiques imposées par l’Union européenne et les États-Unis ont permis d’affaiblir la capacité de Moscou à financer son effort de guerre. Ces mesures ont également eu des répercussions sur l’économie mondiale. La hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires a affecté de nombreux pays. En Europe, les sanctions ont accéléré la transition énergétique, mais ont aussi provoqué des difficultés économiques, en particulier pour les industries dépendantes des matières premières russes.
L’Union européenne traverse une période de profonde remise en question. L’utilisation du Fonds européen pour la paix pour financer des livraisons d’armes représente une rupture historique avec les principes fondateurs de l’UE, marquant l’abandon de sa posture exclusivement civile. Ce changement de paradigme révèle la vulnérabilité géopolitique que représente la dépendance au parapluie américain.
Par ailleurs, l’évolution du conflit met en lumière des dynamiques internationales complexes.
Illustrées d’une part, par la récente implication nord-coréenne, qui pose la question de l’émergence d’un nouvel équilibre géopolitique où des alliances inattendues se dessinent. Certains services de sécurité européens, anticipent même une possible extension du conflit avant 2029, incitant plusieurs pays à renforcer leurs capacités militaires et leurs dispositifs de défense territoriale
Illustrées, d’autre part, par le changement de leadership aux États-Unis avec l’investiture de Donald Trump en janvier 2025. Ce tournant politique alimente les incertitudes quant à la continuité du soutien occidental à l’Ukraine. Trump a promis de “mettre fin à la guerre”, sans toutefois définir de stratégie précise. Cette posture oblige Volodymyr Zelensky à composer avec une diplomatie plus incertaine et des relations de plus en plus tendues avec les États-Unis. En effet, la perspective de concessions territoriales, notamment celles riches en minerais, pourrait devenir une réalité politique difficile à accepter.
Ces différents éléments nous permettent d’affirmer que le conflit, loin d’être un simple affrontement local, redéfinit en profondeur les équilibres géopolitiques internationaux. Son issue influencera durablement l’ordre international et la sécurité européenne.
Le maintien de canaux de négociation reste, dès lors, crucial. Par ailleurs, un accord de paix politique, visant à résoudre des différends territoriaux ou sécuritaires, ne saurait suffire. Les enjeux vont bien au-delà de simples compromis gouvernementaux, car ils touchent aux fondements de l’identité nationale et aux récits historiques qui divisent les communautés ukrainiennes et russes. Dans ce contexte, il est indispensable de mettre en place des processus de réconciliation destinés à transformer ces croyances enracinées. De plus, la reconstruction devra intégrer une forte dimension environnementale afin d’atténuer les effets des destructions. Enfin, parallèlement, la lutte contre la désinformation – par le biais de l’adoption d’outils de fact-checking, le soutien au journalisme indépendant et une meilleure éducation aux médias – s’impose comme une priorité.
2025 s’annonce comme une année décisive et sera marquée par la capacité des acteur·rices européen·nes et internationaux à s’adapter aux évolutions du conflit, à maintenir une solidarité politique et à explorer des voies diplomatiques crédibles. Cette approche sera déterminante non seulement l’issue du conflit mais aussi la nature de l’ordre international émergent.
Louise Lesoil.
[1] Le système Swift (pour Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) facilite les transactions financières et les transferts d’argent pour les banques du monde entier.