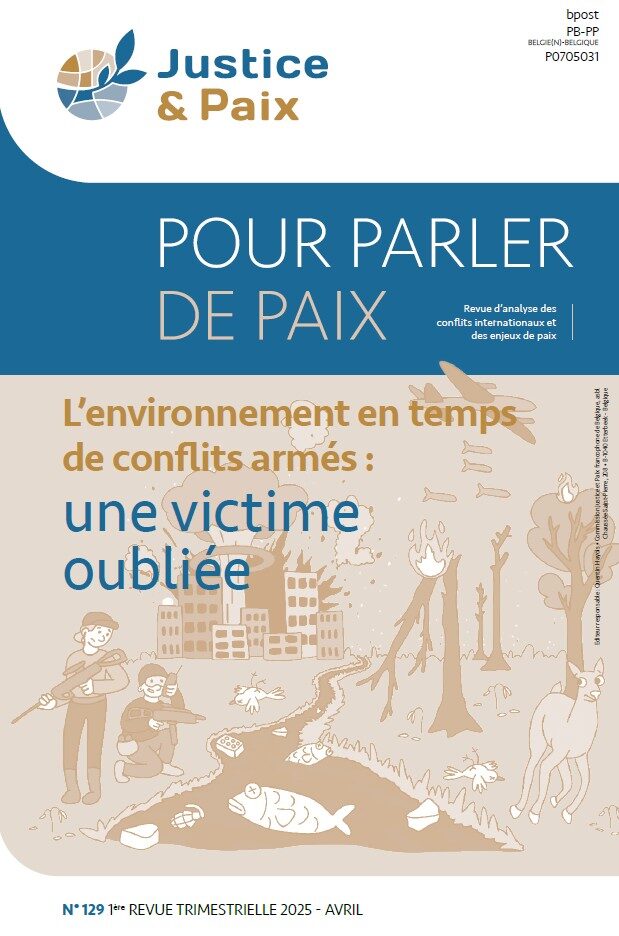La prise de Goma et Bukavu par le M23 a ravivé les violences en RDC. Souvent présentée comme une crise ethnique, cette lecture occulte des enjeux historiques et économiques liés à la colonisation. Une approche décoloniale est essentielle pour en comprendre les causes profondes.

Fin janvier 2025, le monde apprenait avec effarement la prise de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l’Est de la République démocratique du Congo, par le groupe armé du mouvement du 23 Mars (M23). Depuis lors, le groupe armé, notoirement appuyé par le régime rwandais, s’est emparé de la ville de Bukavu, contrôlant désormais les deux grandes villes frontalières. La prise de celles-ci s’est accompagnée de massacres, viols, kidnappings et tortures au su et au vu de toute la communauté internationale. Cette nouvelle vague de violences dans la région peut souvent être présentée comme une problématique ethnique avant tout, comme cela a été le cas lors de la séquence QR du JT de la RTBF du 12 février 2025. Bien qu’il soit indéniable qu’il existe des causes ethniques à ces cycles de conflits, les définir comme causes principales est une opération insidieuse dans un contexte belge, encore profondément empreint de colonialité[1]. Nous allons tenter de démontrer cela en nous fondant sur une approche décoloniale.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devons préciser qu’on ne peut pas correctement aborder les problématiques modernes telles que les conflits, la violence, l’exploitation massive des ressources naturelles, les traumatismes de longues durées et les tensions toujours présentes dans la sous-région des Grands Lacs, sans prendre en considération notre passé commun. Certain∙es sont peut-être perplexes : Pourquoi impliquer la Belgique dans ces conflits alors que les indépendances se sont déroulées il y a maintenant plus de 60 ans et que les relations entre les anciennes colonies et l’ancienne métropole ont bien changé. L’éminent historien belge Jean-Luc Vellut a écrit : « le silence et les hourras du passé pèsent encore sur le présent »[2] (traduction). Par ces mots, il voulait souligner à quel point l’Europe, y compris la Belgique, souffre encore du manque de reconnaissance et de débat sur son passé colonial, longtemps façonné par la propagande et enfoui dans une amnésie collective. Ne pas reconnaitre la grande part de responsabilité des dirigeants politiques européens et belges – et, par extension, le peuple belge – dans la situation actuelle de l’Est de la RDC provient de ce manque de reconnaissance et de débat, et c’est justement ce que déplore Vellut. Son constat explique également la continuité de la colonialité, notamment en Belgique. Les relations entre la Belgique et ses anciennes colonies ont certes changé mais il n’y a pas eu de véritable rupture en termes d’approche et d’idéologie avec l’époque coloniale. Au contraire, tout porte à croire que le logiciel colonial perdure dans ce qu’Anne Wetsi Mpoma, historienne de l’art et experte de la Commission Parlementaire « Passé colonial », appelle : « le colonialisme contemporain »[3]. Elle le définit comme : « les manifestations contemporaines de cette volonté de domination occidentale et dont les fondements idéologiques se retrouvent dans l’idéologie coloniale […] Étant donné que malgré la décolonisation des états africains, aucune rupture n’a réellement été opérée tant au point de vue institutionnel qu’idéologique, il me paraît tout à fait justifié de parler de colonialisme contemporain plutôt que de chercher des liens entre colonialisme et racisme structurel comme si à aucun moment, il y avait eu rupture avec le colonialisme dans nos sociétés »[4].
Si on veut comprendre pourquoi c’est problématique, surtout en Belgique, de dire que la question ethnique est l’enjeu principal des conflits aux Kivus, sans creuser plus loin, il faut se pencher et analyser deux éléments en particulier. Premièrement, le rôle unique du Congo dans les intérêts économiques, aussi bien hier qu’aujourd’hui, puis l’impact des pratiques passées liées à ces intérêts et leurs répercussions encore visibles aujourd’hui. Détaillons cela ensemble plus spécifiquement afin que le grand public belge puisse mieux appréhender les causes profondes de la situation terrible à laquelle doivent faire face les Congolais∙es des provinces de l’Est de la RDC, mieux saisir les liens avec la période coloniale et ainsi s’engager vigoureusement pour un monde plus juste et égalitaire.
Le rôle unique du Congo dans les intérêts économiques, aussi bien hier qu’aujourd’hui
Dieudonné Kambayi, auteur invité par l’association belge Fémiya[5], note que « jamais l’Europe, dans l’histoire du monde, ne s’est montrée aussi collaborative que lors de la division et du partage de l’Afrique »[6] . Cette collaboration démontre les intérêts économiques significatifs que les pays occidentaux possédaient pour l’Afrique et l’Africain déjà autrefois. Toutefois, dans le projet colonial européen, le cas du Congo se distinguait des autres par « l’intérêt particulier que [les richesses du] sol et le sous-sol avaient suscité vis-à-vis des [dirigeants] européens »[7], ce qui explique d’ailleurs pourquoi le Congo a d’abord été reconnu comme un Etat avant de devenir une colonie en 1908. Rien ne prouve que cet intérêt soit passé. Au contraire, tout porte à croire que l’obsession économique occidentale envers le Congo n’a pas pris fin et reste d’actualité. Dans son livre Congo Inc: Le testament de Bismarck, Koli Jean Bofane explique que, nourris par cette obsession, les occidentaux ont développé ce qu’il appelle « l’algorithme Congo Inc. ». Cet algorithme, qui est régulièrement « mis à jour quelque part entre Washington, Londres, Bruxelles et Kigali », désigne la logique impitoyable d’un système qui, depuis la colonisation, a perpétué l’exploitation du Congo et de ses habitants, transformant le pays en une machine à générer des profits pour des intérêts étrangers, souvent au détriment de son propre développement.
Cette logique, héritage principal du colonialisme, perdure encore aujourd’hui, mais sous de nouvelles formes, notamment avec l’essor du capitalisme mondial et l’implication croissante de nouvelles puissances comme les USA ou la Chine. Alors quand, pour la transition écologique, le monde est tributaire de matières premières essentielles dont regorge le sol et sous-sol congolais, ces puissances capitalistes et leurs entreprises, en ce compris l’Union Européenne (UE), s’appuient gracieusement sur l’algorithme Congo Inc, entrainant ainsi la Belgique dans une complicité tacite. Cet algorithme a certes évolué, mais il conserve bien son objectif et son contrecoup principal : l’exploitation intensive des ressources naturelles congolaises au détriment de ses habitant∙es. Plusieurs éléments l’attestent : D’un côté, on observe que le régime rwandais bénéficie d’un soutien international significatif, en particulier sur le plan économique, avec des accords visant à renforcer les échanges, notamment avec l’UE sur les matières premières stratégiques. De l’autre, on assiste à une explosion des exportations de minerais comme le coltan, extrait du sous-sol congolais mais expédié par le Rwanda, après des massacres et des pillages orchestrés par des groupes armés tels que le M23. À cela s’ajoute le soutien des institutions européennes et belges à l’accession contestée au pouvoir d’un Tshisekedi novice et illégitime. En parallèle, le discours timoré de la communauté internationale – beaucoup de condamnations, mais peu d’actions concrètes – vis-à-vis des agresseurs rwandais contraste avec la fermeté affichée lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Pour certain∙es, cela relève de complaisance ; pour d’autres, d’une complicité silencieuse. En définitif, cela témoigne de la perpétuation, consciente ou non, de l’algorithme Congo Inc.
L’impact des pratiques coloniales passées liées aux intérêts économiques et leurs répercussions encore visibles aujourd’hui
Kambayi souligne que : « Le regard économique obsessionnel des occidentaux vers le Congo comme État à des fins commerciales, venant de Léopold II et de la Belgique, a détourné la formation d’une nation dans les règles de l’art »[8]. Comme abordé précédemment, il note que « le but ultime [des politiques coloniales] était d’exploiter le territoire congolais sans se soucier de l’avenir de ses occupants »[9]. Cela est d’ailleurs confirmé par le prince Albert, futur roi des Belges, dans son journal de route lors de son voyage au Congo[10] ou d’autres comme Monsieur Pétillon, Gouverneur Général au Congo belge (1952-58), dans des discours[11]. Un exemple concret de ces politiques coloniales est le déplacement forcé de populations, souvent pour fournir de la main d’œuvre aux travaux forcés. Ce fut, par exemple, le cas de 100 000 Rwandais∙es qui furent transplanté∙es entre 1937 et 1945 dans le territoire de Masisi, dans le Nord Kivu, dans le cadre du programme Mission d’Immigration des Banyarwanda. À cause de ces déplacements, les populations locales ont subi et subissent encore la déstructuration de la gestion des milieux fortement liée aux coutumes respectives de chacun∙e. Cette pratique est tellement catastrophique qu’elle est reconnue, depuis 1949, comme un crime de guerre et un crime contre l’humanité en droit international humanitaire. Ces procédés ont donc débouché sur une déstabilisation profonde de la région, encore perceptible de nos jours.
Les cycles de conflits au Nord Kivu trouvent notamment leur origine dans ces pratiques « d’ingénierie démographique »[12] menées par le gouvernement colonial belge comme rapporté par IPIS[13]. Dès lors, l’aspect ethnique de ces conflits existe bel et bien mais il est essentiel de rappeler, pour éviter tout lecture colonialiste, qu’ils s’inscrivent dans le chaos provoqué par plus d’un siècle de colonialisme. Cette révélation est significative car elle nous aide à saisir le profond héritage colonial qui fondent les conflits actuels au Congo d’une part et à éviter de justifier les conflits actuels au Congo uniquement par la défaillance des différentes administrations politiques congolaises, d’autre part. Elle nous exhorte aussi à éluder les analyses qui invisibiliseraient et ainsi déresponsabiliseraient les états occidentaux et en particulier la Belgique dont les politiques coloniales produisent encore des répercussions néfastes jusqu’à aujourd’hui. En résumé, en se focalisant sur l’aspect ethnique, on participe à la perpétuation du logiciel colonial qui maintient l’image de l’Africain∙e sauvage, dénué∙e de raisons et de considérations pour la vie humaine. Le piège est que cela dépolitise la question auprès du grand public et détourne des enjeux principaux de ces conflits.
En conclusion, nous espérons que cette analyse a mis à nu certains enjeux clés derrière les cycles de conflits en RDC, qui perdurent depuis la colonisation, afin que notre réponse sociétale et politique soit également plus juste. Ce texte ne souhaite pas remettre en question le caractère ethnique des conflits à l’Est du Congo mais veut plutôt interpeller sur les dangers que comportent le fait de le placer comme cause principal sans aller plus loin. Cela invisibilise les responsabilités des autres acteurs internationaux dont la Belgique, impliqués dans les dynamiques de ces conflits depuis l’époque coloniale pour des raisons économiques. Cette invisibilisation et déresponsabilisation s’aligne parfaitement sur les techniques de propagande coloniale qui permettaient de camoufler les pratiques horribles d’exploitation des ressources et des corps des Congolais∙es derrière des narratifs pimpants comme « la mission civilisatrice »[14].
Pour construire un monde plus juste et égalitaire, il est donc de notre responsabilité, en tant que citoyens et citoyennes, de prendre conscience de ces types de mécanismes du logiciel colonial et d’exiger de nos responsables politiques, tant à l’UE qu’en Belgique, qu’ils y mettent fin. Chacun∙e de nous portons cette responsabilité. Nous ne pouvons rester spectateur∙rices car comme disait Albert Einstein : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire ".
Emmanuel Tshimanga.
[1] Jérémie Piolat, Norma Ajari, Achille Mbembe, Françoise Vergès et d’autres penseur∙seuses décoloniaux∙les ont abordé la colonialité comme la persistance des logiques, structures et effets du colonialisme, même après la fin officielle de la colonisation. Là où le colonialisme repose sur une domination politique et territoriale directe, la colonialité se manifeste à travers des inégalités économiques, culturelles, épistémiques et sociales qui perpétuent une hiérarchie entre les anciens colonisateurs et les anciens colonisés.
[2] Jean-Luc Vellut, « Introduction », dans Het geheugen van Congo: de koloniale tijd, éd. Jean-Luc Vellut et al. (Tervuren : Musée royal d’Afrique centrale, 2005), 13.
[3] Commission spéciale chargée d’examiner l’État Indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver. Rapport des experts (2021), 643.
[4] Ibid.
[5] Anciennement connu sous le nom de Bamko asbl.
[6] Dieudonné Kambayi, Du frein au levier pour le développement : le Congo face aux défis interculturels (Bruxelles : Kwandika de Bamko-Cran asbl, décembre 2023), 2.
[7] Ibid.
[8] Ibid., 3.
[9] Ibid., 4.
[10] “ Malheureusement la hâte intéressée à recueillir du Congo de grands profits a fait négliger la plupart des problèmes dont la solution importait à la prospérité durable de la Colonie … » dans Raymond Buren, Journal de route du Prince Albert en 1909 au Congo (Bruxelles : Éd. Mols, 2008), 133.
[11] “ C’est en fonction de nous-mêmes que nous avons relié les diverses parties de ce qui s’appelle aujourd’hui le Congo, par des moyens de communications divers, c’est pour nos besoins et pour ceux de nos travailleurs que nous avons provoqué des transports de produits et de vivres », dans Emile Bongeli, Sociologie politique. Perspective africaine (Paris : L’Harmattan, 2020), 17.
[12] Expression glaçante utilisée par le Conseil de l’Union européenne dans un communiqué de presse relatif à la situation syrienne.
[13] Ken Matthysen et Martin Doevenspeck, Le M23 “version 2” : Enjeux, motivations, perceptions et impacts locaux (Tervuren : International Peace Information Service, 2024).
[14] Les différents pays ayant colonisés lors des XIXe et XXe siècles justifiaient leurs projets coloniaux différemment selon leur contexte mais une constante persista au sein des discours justificatifs : la volonté de civiliser les peuples colonisés, en sachant que le standard de cette civilisation correspondait au modèle des sociétés européennes occidentales (enseignement, soins de santé, développement urbain, etc.).