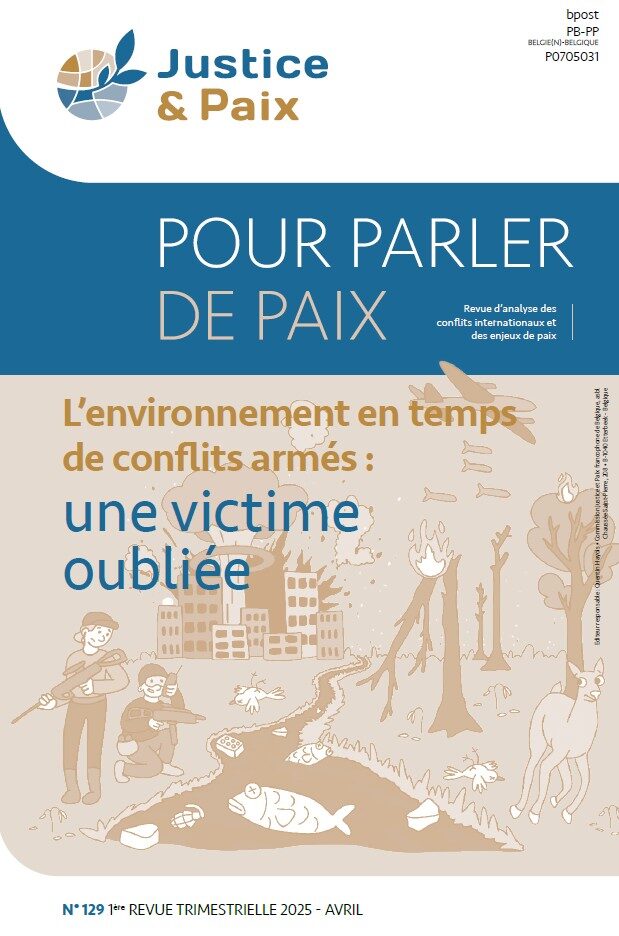Chaque jour, l’effroi nous saisit un peu plus. La guerre s’est installée comme une composante permanente de l’actualité sous les yeux impuissants de la communauté internationale qui peine à trouver des solutions satisfaisantes et durables. C’est dans ce contexte d’instabilité que l’ONU organise la semaine du désarmement, du 24 au 30 octobre 2024, pour sensibiliser et encourager les actions visant à réduire les armes, qu’elles soient nucléaires, chimiques, biologiques ou conventionnelles. Paradoxalement, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 443 milliards de dollars en 2023, une hausse de 6,8 % par rapport à 2022, la plus forte depuis 2009, notamment à cause du conflit en Afghanistan. La Belgique s’inscrit également dans cette tendance.

Crédit : Chaikong2511
Civils et environnement : les premières victimes de la puissance des armes
De Khakiv, en passant par Rafah et Beyrouth, les civils sont en première ligne des conflits. Réfugié·es dans des écoles, des hôpitaux, des souterrains ou simplement chez eux, les populations subissent de plein fouet les frappes des missiles et des drones. Ces armes sont devenues toujours plus perfectionnées, grâce notamment aux nouvelles technologies, les transformant en instrument de destruction massive. Par exemple, le Hamas, groupe armé présent dans la bande de Gaza, a utilisé des drones télécommandés pour détruire des infrastructures israéliennes, tandis que l’armée ukrainienne s’appuie sur des algorithmes pour ajuster les trajectoires de ses munitions rodeuses. Mais en termes de technologie, c’est bien l’armée Israélienne qui détient les armes les plus avancées. L’Etat hébreux, est accusé d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) afin de cibler des civils. Il s’appuie sur le programme d’IA « Lavender », conçu pour identifier tous les agents présumés des ailes militaires du Hamas, y compris les moins gradés, comme des cibles potentielles pour les bombardements. Cette IA aurait joué un rôle prépondérant dans la première phase de la guerre et identifié 37 000 palestinien·nes comme des militant·es et mis sur une « kill list ». On assiste alors à une déshumanisation des civils en temps de conflit, un processus très commun en période de guerre, qui consiste à considérer une personne ou un groupe comme inferieur, non humain, en dehors des normes et des valeurs de la société. Par ailleurs, l’usage de l’IA dans les conflits posent de nombreuses questions éthiques et notamment relatives à la fiabilité des informations qui sont récoltées. L’utilisation des technologies pourrait même aller plus loin. L’ONU s’inquiète de la prolifération des armes entièrement autonomes, qui pourraient se passer totalement de l’intervention humaine. Ainsi, la robotisation du champ de bataille avance plus vite que la régulation des armes, et ce sont les civils qui en paient le prix le plus lourd. Mais nous ne devons pas oublier également un second dommage collatéral de cette prolifération : l’environnement.
Il existe un cout que nous ne pouvons plus ignorer : celui de l’impact environnemental de la guerre. Depuis 2001, les Nations Unies ont désigné le 6 novembre comme la « Journée internationale pour la prévention de l’exploitation en temps de guerre et de conflit ». Les conflits armés causent des dommages environnementaux graves et durables, dont les conséquences peuvent être irréversibles. L’exemple emblématique de l’agent orange, un herbicide toxique utilisé par les États-Unis au Vietnam, a marqué l’une des premières prise de conscience des ravages que la guerre cause sur les écosystèmes. Cinquante ans après ce conflit, de nombreuses terres restent stériles, et les populations continuent de souffrir de ses effets dévastateurs. Aujourd’hui, l’urgence climatique, nous impose de nous saisir de cet enjeu. Les conflits en Ukraine et au Proche-Orient en sont des exemples frappants. Les combats impliquent l’usage d’armes destructrices telles que les bombes, les munitions ou les mines, qui laissent derrière elles des résidus toxiques et des métaux lourds. Ces substances contaminent les sols, rendant les terres inexploitables à l’agriculture, et empoisonnent parfois les ressources en eau. Les conflits augmentent également les rejets en Co2, dans un contexte où nous devons impérativement les réduire. En Ukraine, une étude intitulée « dommages climatiques causés par la guerre russe en Ukraine » révèle que le conflit, associé au sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, a généré en une année plus de 120 millions de tonnes de Co2. Cela représente l’équivalent des émissions annuelles d’un pays comme la Belgique. Les bombardements intensifs sont responsables de ces émissions massives de gaz à effet de serre, accentuant ainsi la crise climatique mondiale.
Dans la bande de Gaza, l’écosystème est aussi fortement endommagé en raison du conflit actuel selon un rapport du Programme des Nations Unies sur l’environnement. Une enquête menée par le groupe de recherche Forensic Architecture met en lumière l’invasion terrestre d’octobre 2023, qui a déraciné des vergers et ciblé systématiquement des exploitations agricoles[1]. Le sol devient infertile, et les produits incendiaires contenus dans le phosphore blanc libéré par l’armée israélienne continueront de polluer l’air pendant des années. Il s’agit d’une arme incendiaire, qui, lorsqu’elle rentre en contact avec de l’oxygène, s’enflamme et brûle et produit une fumée blanche particulièrement toxique. Son rayon d’impact est considérable, et les effets sur la biodiversité sont dévastateurs. Cette arme n’est pas seulement néfaste pour l’environnement ; elle est également meurtrière pour les êtres humains. Bien que son utilisation soit encadrée par le droit international, elle n’est pas totalement interdite. Le protocole III de la Convention sur certaines armes classiques, en vigueur depuis 1983, interdit son emploi contre des civils ou dans des zones densément peuplées. Cependant, la Russie sur les territoires ukrainiens et syriens et en Syrie, tout comme les États-Unis au Vietnam, ont déjà fait usage de cette arme controversée.
A l’horreur des massacres s’ajoutent des catastrophes écologiques sans précédent. Les violences de la guerre sur les civils et l’écosystème ne peuvent pas être dissociées. Lorsque les armes sont utilisées dans des zones civiles, elles causent également des ravages écologiques. Et lorsque des écosystèmes entiers sont détruits, ce sont les populations locales qui en paient le prix fort.
Quelle responsabilité pour les Etats dans la neutralisation des forces armées ?
Depuis sa création en 1945, l’ONU s’efforce d’interdire les armes et leur mise en circulation dans l’objectif de maintenir la paix et la sécurité internationale. La bombe atomique déposée sur Hiroshima le 6 août 1945 a mis le contrôle de l’arme nucléaire, la plus dangereuse au monde, au centre des préoccupations de la communauté internationale. Toutefois, il est essentiel d’appréhender la perspective du désarmement d’un point de vue large. Ce processus concerne différentes catégories d’armes : les armes nucléaires, biologiques, chimiques, conventionnelles, ou de petit calibre. Le désarmement peut être le fruit d’une démarche individuelle d’un Etat, aussi et surtout d’un processus collectif donnant naissance à des accords internationaux. Depuis 1968, neuf traités visant à éliminer la production, l’utilisation et la prolifération des armes qu’elles soient conventionnelles, nucléaires, chimiques ou biologiques ont été signés par plusieurs Etats. Malgré la mise en œuvre de ces instruments juridiques, de nombreux défis subsistent. Dans un premier temps, la prolifération des technologies utilisées à des fins de stratégies militaires exige une vigilance accrue et une adaptation des normes internationales. Face au risque croissant de l’automatisation des armes dans les conflits, il est impératif que les individus conservent toujours le contrôle de la force[2].
En parallèle, la question de la vente et des exportations d’armes a pris une place centrale dans le débat public, notamment en Belgique. Le secteur wallon de l’armement, particulièrement attractif, en est un exemple. Le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), recense 44 entreprises “ayant une activité de production de biens et de services à usage militaire” en Région wallonne, employant au total 3 604 personnes. Parmi celles-ci, des firmes telles que BATS ou FN Herstal ont été accusées d’avoir fourni des armes utilisées contre des civils à l’étranger[4]. L’Arabie Saoudite, longtemps premier client des exportations wallonnes, a reçu entre 2014 et 2019 des licences d’exportation pour un montant total de 1,7 milliard d’euros, malgré son implication dans le conflit au Yémen, où elle est accusée de crimes de guerre[5]. De plus, entre novembre 2023 et mars 2024, Amnesty International Belgique et la CNAPD ont révélé que 70 tonnes d’explosifs et de munitions, transportées par une compagnie israélienne à destination d’Israël, ont transité par l’aéroport de Liège. Pourtant, à la suite des risques de génocides dans la bande de Gaza pointée par la Cour de Justice International de Justice en février 2024, le gouvernement belge avait pris l’engagement de ne plus de ne plus accorder de licences de transit ou d’exportation vers Israël. Suite à la mobilisation des ONG et de la société civile, la législation wallonne a été modifiée. La Belgique se doit d’exercer un devoir de vigilance et de transparence concernant l’usage des armes exportées ou en transit sur son sol, conformément à ses obligations juridiques en tant que partie au Traité sur le Commerce des Armes, qui interdit la vente ou le transit d’armes si elles risquent d’être utilisées contre des civils. Cependant, la majorité gouvernementale wallonne élue à la suite des élections du 9 juin 2024, semble adopter une direction contraire. La Déclaration de politique régionale (DPR) prévoit une révision du décret de 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense. La DRP annonce en effet une révision du décret de 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense, en vue « de ne plus pénaliser les industriels wallons dans leurs exportations au regard du cadre appliqué au niveau intra-belge et européen et en s’en tenant strictement à ce dernier ». Le message envoyé par le gouvernement wallon est préoccupant. Le texte de DPR considère ce décret comme pénalisant l’industrie wallonne d’armement. Comme l’explique Amnesty International Belgique, le principal intérêt du décret de 2012 est qu’il intègre des mesures relatives au respect des droits humains. Ainsi les autorités doivent refuser d’accorder une licence d’exportation lorsqu’il existe un risque manifeste que les armes concernées servent à commettre des violations des droits humains ou du droit international humanitaire. Il s’agit d’un principe de précaution And non une mesure de pénalisation des industries wallonnes. Le gouvernement wallon devrait se concentrer davantage sur la transparence et le contrôle des ventes d’armes à l’étranger, plutôt que d’assouplir le décret de 2012, qui lorsqu’il est bien appliqué, empêche l’utilisation d’armes belges contre des civils.
Le droit à la paix, une obligation de désarmement
Après la seconde guerre mondiale, de grands espoirs de réduire les arsenaux et les forces armées sont nés. Cependant, face à un ordre mondial en crise, de nombreux États ont choisi d’augmenter leur budget militaire, convaincus que cela garantirait une plus grande sécurité. Pourtant, les enjeux du désarmement sont multiples et interconnectés. Au cœur de ces défis se trouve la volonté de prévenir les conflits et de réduire les risques d’escalade militaire pouvant mener à la guerre. L’enjeu est également humanitaire : le désarmement permet d’éviter des catastrophes humanitaires et environnementales, comme celles que nous observons aujourd’hui. L’enjeu est aussi économique car l’investissement dans les dépenses militaires pourrait être affecté à d’autres secteurs essentiels comme l’éducation, la santé, la justice notamment. Cependant, l’ensemble de ces étapes nécessitent une volonté politique et l’engagement des Etats dans un processus de coopération internationale et de transparence. Agir pour le désarmement, c’est œuvrer pour la paix, la sécurité et la justice. Une paix durable ne pourra être atteinte qu’à travers un processus de justice, garante de la mémoire et de la vérité, pour toutes les victimes de crimes et de violations des droits humains.
Suzanne Dufour.
[1] Anne X. Nguyen, « Lucia Rebolino (Forensic Architecture) : « La destruction
de Gaza est un acte généralisé et délibéré d’écocide », Éclairage du GRIP, 24 septembre
2024.
[2]“Armes autonomes : le CICR appelle les Etats à prendre des mesures en vue de la négociation d’un traité”, declaration du CICR, le 08-08-2022
[4] Amnesty International, « Armes wallonnes : des exportations hautement problématique mises en évidence moins d’un an avant les élections régionales », 28 Juin 2023
[5] RTBF, « Est-il possible de vendre des armes à l’Arabie Saoudite en respectant les droits de l’homme », le 26 septembre 2022